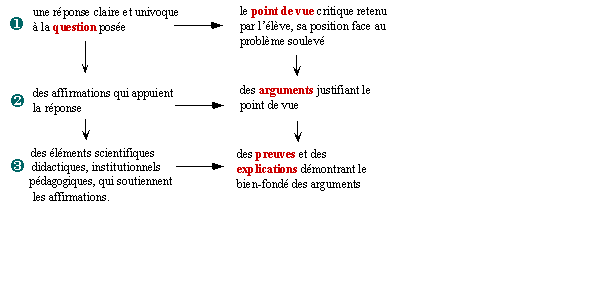Travaux dirigés 3
: La dissertation critique
Une dissertation critique
est un exposé écrit et raisonné sur un sujet qui porte
à discussion. Il s'agit donc d'un texte suivi dans lequel l'étudiant
doit répondre à un sujet qui lui demande de prendre position
et de soutenir un point de vue. Par définition, la dissertation
critique exige un texte argumentatif, c'est-à-dire un texte qui
démontre un point de vue en l'appuyant par un système argumentatif
cohérent et convaincant.
Un argument est une
affirmation qui explique ou justifie le point de vue retenu par l'étudiant.
Le bien-fondé
des arguments est démontré par des preuves tirées
des connaissances de l'étudiant et par des explications.
Voici schématiquement
les différents éléments qui forment le système
argumentatif d'une dissertation critique :
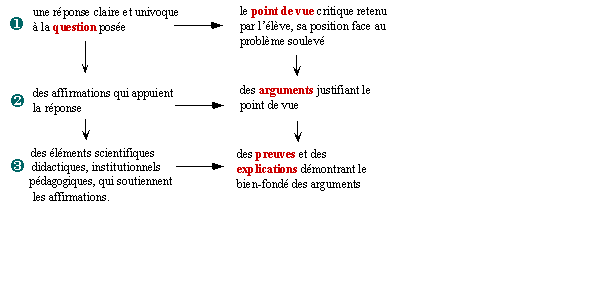
On comprendra que la dissertation critique se distingue de l'essai
critique par le fait que le point de vue de discussion sur les connaissances
est déterminé à l'avance. Une affirmation est parfois
fournie dans le sujet et l'étudiant doit acquiescer à cette
affirmation, la nier ou la nuancer. L'étudiant, dans sa rédaction,
devra donc démontrer que son point de vue est valable.
C'est un peu comme s'il fallait se placer dans la peau d'un avocat qui
prépare une plaidoirie pour faire valoir un point de vue. Il est
alors nécessaire de démontrer que ce point de vue est le
bon en montrant les arguments et les preuves qui le soutiennent. Le juge
est alors le lecteur (correcteur).
Travaux dirigés 3 : Le
travail de groupe
2 modalités au choix des
étudiants:
Les groupes sujets
Les groupes synthèses
Les groupes sujets :
-
analyse du sujet
-
10' individuel
-
10' groupe
-
10' correction pour tous (sujet + synthèse)
-
faire plan détaillé
-
10' individuel
-
10' groupe
-
10' correction pour tous (sujet + synthèse)
-
hypothèse de travail
-
10' individuel
-
10' groupe
-
10' correction pour tous (sujet + synthèse)
sujet au tableau
Les théories scientifiques fondent parfois l'action des enseignants
d'EPS. Discutez cette affirmation et dites comment elle influence le choix
des contenus d'enseignements.
Les groupes synthèses :
-
Rédiger un cas concret à partir du corrigé de la synthèse
du texte de Chanon. 20'
-
10' correction pour tous (sujet + synthèse)
-
Faire la synthèse d'un texte 20'
-
10' correction pour tous (sujet + synthèse)
ROTATION DES TÂCHES
-
Rechercher les pistes d'utilisation de cette connaissance 20'
-
10' correction pour tous (sujet + synthèse)
Texte de R. CHANON revue Hyper N° 205 page 25
Résumé de ses propositions:
Un praticien R. Chanon s'élève contre les modes qui traversent
le monde de l'EPS en étant issues de données scientifiques
mal comprises. Il s'appuie sur la critique de l'utilisation de la notion
de durée dans les courses longues et de l'entrainement dit 15/15.
d'après lui, les élèves sont plus centrés
sur la distance, élément concret, que sur le temps qui reste;
pour eux, une abstraction. La question du sens est ici posée. Quant
au 15/15, ses constatations de terrain l'amènent à rejeter
ce modèle à cause de l'insuffisance de temps de récupération.
La validité du modèle théorique sur lequel repose
cette pratique est alors interrogée.
Exemple de cas concret:
A partir d'une analyse critique des propositions parfois aberrantes
qu'entraîne une application mécaniste de théories scientifiques
à une pratique (la course de durée) un professeur EPS R.
Chanon envisage un fonctionnement centré sur l'individualisation
de l'entraînement. Sa priorité est d'obtenir une baisse de
10 à 20 pulsations cardiaques par minute avant de solliciter à
nouveau les organismes des élèves . Pour cela, il met en
place des groupes effectuant des distances d'environ 100m à
parcourir en 16, 17, 18 secondes selon leur VMA. Dans un deuxième
temps, il retire de ces groupes les individus qui ne peuvent obtenir
une baisse de rythme cardiaque suffisante (10/20 pulsations) en 30/40 secondes.
Il accorde un délai de récupération supplémentaire
à ces élèves pour leur permettre de ralentir leur
rythme cardiaque.
Synthèse pour mémorisation:
R. Chanon revue Hyper 205
-
Praticien
-
rejete l'application mécaniste de théories aux pratiques
-
amène des aberrations
-
de sens pour les élèves
-
de validité des modèles
-
donne l'exemple du 15/15
-
critique la notion de durée dans les courses longues
-
la récupération des efforts doit être gérée
de façon individuelle.
Ses PROPOSITIONS
-
Obtenir une baisse du rythme cardiaque de 10/20 puls. mn
-
travail autour de 100 m en 16", 17", 18" selon VMA
-
durée de récupération active ou passive double de
la durée de l'effort
-
gestion des groupes: retirer les individus hors moyenne